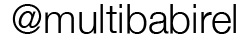ENTRETIEN
« Il est possible de former et d’effacer des souvenirs »
LE MONDE SCIENCE ET TECHNO,
le 6 octobre 2014 à 20h56
Forum « Les Fondamentales ». Pour le neurobiologiste Pierre-Marie Lledo, les possibilités de manipulation de la mémoire sont aujourd’hui clairement démontrées.

Pierre-Marie Lledo. | Charles Fréger pour » Le Monde »
Le neurobiologiste Pierre-Marie Lledo dirige le département des neurosciences de l’Institut Pasteur (Paris) et le laboratoire Gènes, synapses et cognition du CNRS. En 2003, son équipe avait mis en évidence l’existence de cellules souches dans le cerveau adulte, bouleversant un dogme de la neurobiologie. Depuis, elle a caractérisé les fonctions de ces néoneurones dans les mécanismes d’apprentissage et de mémorisation.
Pierre-Marie Lledo a été le premier en France à utiliser l’optogénétique, cette nouvelle technique alliant optique et génétique, qui permet d’activer ou d’inhiber l’activité d’un neurone précis. Il est par ailleurs l’auteur, avec Jean-Didier Vincent, d’un ouvrage grand public, Le Cerveau sur mesure (Odile Jacob, 2012).
Rencontre avec un chercheur enthousiaste, pour un tour d’horizon des dernières découvertes concernant la mémoire et la plasticité du cerveau humain.
L’arrivée de techniques de pointe comme l’optogénétique bouleverse les connaissances dans le domaine de la mémoire. Quels sont les résultats les plus marquants ?
Depuis deux ans, une série de travaux a permis de démontrer clairement les possibilités de manipulation de la mémoire. En 2012, Susumu Tonegawa, qui travaille à l’Institut Riken de Tokyo et au MIT (Massachussets Institute of Technology), est ainsi parvenu avec son équipe à modifier les souvenirs stockés dans l’hippocampe d’un rongeur, avec une technique d’optogénétique. Un an plus tard, ces mêmes chercheurs ont montré combien notre mémoire reste un processus fragile, instable, en découvrant qu’il est possible de substituer un souvenir par un autre, voire d’introduire de faux souvenirs dans la mémoire d’une souris. Leurs travaux, publiés dans la revue Science, indiquent aussi qu’il est possible de faire cohabiter dans le cerveau deux souvenirs désagréables, l’un vrai et l’autre faux. Encore plus surprenant, cette équipe a observé que mémoire fictive et mémoire réelle activent les mêmes régions cérébrales. La frontière entre le réel et l’imaginaire s’estompe dès lors qu’il s’agit de mémoire, un principe déjà mis en scène dans des films comme Total Recall ou Inception.
Le groupe de Roberto Malinow (San Diego, Californie) vient de son côté de prouver qu’il est possible de former un souvenir, de l’effacer puis de le réactiver à volonté à l’aide de l’optogénétique.
Bien sûr, ces capacités de transformation ou de reprogrammation de la mémoire étaient déjà connues, mais de façon empirique. Avec l’optogénétique, les bases sont plus rigoureuses et quantitatives, et cela donne un véritable support aux thérapies cognitivo-comportementales. Inversement, si l’on accepte l’idée que la mémoire n’a rien de fiable, il faut se poser des questions sur les méthodes psycho-analytiques fondées sur la résurgence de souvenirs, et, au-delà, sur la valeur juridique des témoignages. Finalement, tout cela pousse à s’interroger sur notre devenir, car ce qui fait l’humain n’est ni dans son sang ni dans ses muscles, mais dans son cerveau. Dès lors qu’on y touche…
On voit bien à quelles fins ces recherches pourraient être appliquées, par exemple pour générer des soldats qui n’ont plus peur de la peur, ou qui garderaient un souvenir positif d’événements très négatifs.
L’optogénétique n’a été testée que chez des rongeurs et des primates non humains. N’est-il pas prématuré d’extrapoler ses résultats à l’homme ?
Aujourd’hui, le problème de l’application de cette technique à l’humain est de pouvoir focaliser la lumière précisément en un seul endroit, en profondeur, tout en traversant la boîte crânienne. Le canal rhodopsine, la protéine qui permet de rendre les neurones photosensibles, est issu des algues, donc d’un milieu aquatique. En clair, l’optogénétique utilise une lumière bleue, c’est-à-dire une onde lumineuse qui pénètre l’eau en profondeur mais pas le cerveau. Faute de pouvoir passer à travers l’os, cela nécessiterait une trépanation. Aussi beaucoup d’équipes cherchent à mettre au point des protéines stimulables par la lumière, non plus dans le spectre visible, mais dans l’infra-rouge, des longueurs d’ondes qui pénètrent bien mieux les tissus nerveux.
En attendant, d’autres techniques ont déjà prouvé leur efficacité lors d’essais cliniques. Récemment, une équipe californienne a montré qu’une stimulation d’une région cérébrale appelée le cortex entorhinal améliore les performances de sujets participants à un jeu électronique qui exige que les joueurs apprennent rapidement puis se rappellent où déposer des passagers d’un taxi dans une ville virtuelle. Dans ce cas, la frontière entre cerveau réparé et cerveau augmenté, a été franchie.
Dans une autre recherche, publiée fin août dans Science, des chercheurs ont pu améliorer de 30 % les performances cognitives d’individus à l’aide d’une méthode non invasive, la stimulation magnétique transcrânienne.
Qu’en est-il des recherches sur les liens entre mémoire, sommeil et rêves ?
C’est aussi un domaine en pleine effervescence. Il est maintenant démontré que les rêves permettent de consolider des informations (surtout implicites) et d’oublier ce qui s’avère peu utile. Beaucoup de personnes aimeraient être hypermnésiques, mais l’oubli est un processus adaptatif aussi important que la mémoire. Nous ne pourrions pas avancer dans la vie si nous n’étions pas capables d’oublier les situations d’adversité, le ressenti des douleurs…
Il y a une dizaine d’années, Matt Wilson, chercheur au MIT, a soumis des rats à une épreuve de labyrinthe, en enregistrant leur activité cérébrale. Et il a montré que le même schéma d’activité neuronale réapparaît pendant leur sommeil, ce qui signifie que ces animaux rêvent du labyrinthe.
Si l’on contrecarre ces impulsions électriques nocturnes, les performances des rats diminuent, comme s’ils perdaient le bénéfice de l’expérience. Plus fort encore, ces séquences électriques appelées engrammes, qui sont le support physique de l’apprentissage, ont pu être transférées d’un rat entraîné à un animal naïf.
Comment expliquer le contraste entre ces belles démonstrations et l’absence de traitements efficaces pour les maladies neurodégénératives comme Alzheimer ?
Pratiquement tous les grands laboratoires pharmaceutiques se sont retirés des recherches fondamentales en neuroscience pour développer seulement des partenariats avec des équipes académiques. Ce désengagement tient à plusieurs particularités du cerveau.
A chaque étape de la recherche, le risque d’échec est plus élevé, car la mise en réseau de neurones fait apparaître des propriétés émergentes, ce qui n’existe pas dans d’autres domaines de la médecine. En outre, chaque cerveau étant unique du fait de sa plasticité, le nombre de patients nécessaires pour une étude clinique sérieuse doit être très élevé. Enfin, le temps entre une découverte fondamentale et la mise sur le marché d’une molécule est particulièrement long en neurosciences, il ne correspond plus au modèle économique placé sous l’égide d’actionnaires.
Il est difficile de prédire si les solutions pour ces maladies viendront de médicaments ou de techniques. Mais il est désormais prouvé que les circuits cérébraux peuvent être reconfigurés, ce qui n’était même pas envisageable il y a cinq ans.
Faut-il craindre ou se réjouir de l’arrivée d’interfaces cerveau machine ?
Personne n’est choqué par le port de lunettes, mais la société a encore du mal à accepter qu’un individu puisse être un cyborg. Ces craintes sont d’autant plus présentes que la plupart des recherches se font loin de nous, aux Etats-Unis ou en Asie. Pourtant, nous sommes déjà entrés dans l’ère du transhumain. Il faut accepter le progrès sous réserve qu’il soit équitable.
Pour ma part, je suis extrêmement optimiste car la science contemporaine fonctionne désormais sur un mode participatif, avec des systèmes de consortiums, de partage des données, de crowd-sourcing…
Si l’on réussit à impliquer suffisamment d’individus, la science participative permettra de décider ensemble sur les grandes questions éthiques. Rappelons que la France a été pionnière en créant un comité d’éthique national, dès 1983, mais évidemment cela ne suffit plus aujourd’hui. Pour l’heure, les débats citoyens sont difficiles à organiser. Il est urgent de faire un travail de fond sur l’opinion publique pour qu’elle retrouve un intérêt à construire une société de la connaissance et du partage.