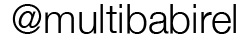Dans l’enfer des « jobs à la con »
Par Lorraine de Foucher
Le 22 avril 2016 à 13h09
Mis à jour le 22 avril 2016 à 19h29
L’émiettement des tâches au bureau donne à beaucoup le sentiment d’occuper un emploi dénué de sens. Les « bullshit jobs » sont-ils le mal du siècle ou seulement une étape dans la mutation du travail ?
Image extraite de la série « Open space », commencée en 2012. | Muriel Bordier
Qui sait à quoi consacre ses journées un consultant en concertation ? Et un chef of happiness officer (« responsable du bonheur » dans une entreprise) ? Ou encore le manageur du management ? Il est facile et tentant de moquer la profusion de ces métiers aux contours mal définis, connus pour distiller une bonne dose d’ennui et parfois une sorte de mal-être. Encore plus tentant de s’en gargariser dans une ère de chômage de masse.
Impossible, pourtant, d’ignorer la progression de ce nouveau « mal » de l’époque, qui gagne de plus en plus de jeunes salariés et que les musiciens de Fauve avaient décrit dès 2013. Sainte-Anne, l’un de leurs premiers succès, se penchait sur la vie de bureau avec acuité, comme en terrain de connaissance. « A l’époque, on avait tous des boulots de gens qui ont fait de longues études, la journée derrière l’écran, partis sur des rails pour quarante ans, sans trop de sens », rappelle aujourd’hui l’un des membres du collectif français (dont on n’aura ni le nom ni le prénom, puisqu’ils ont pour principe de rester anonymes). « Des centaines de gens nous ont écrit en nous disant qu’ils se retrouvaient beaucoup dans ce titre », ajoute-t-il.
« Ce métier impossible à définir en une phrase »
Ces « gens », ce sont ces aimables inconnus qui deviennent soudain inintelligibles quand survient, au détour d’une conversation, la question : « Tu fais quoi dans la vie ? » Leur réponse, des tentatives d’explications mâtinées d’anglicismes, eux-mêmes imbriqués dans un langage commercio-managérial, est généralement suivie d’un grand silence. Cet autre, au travail apparemment absurde, n’est pas juste amputé de sa capacité de vulgarisation, il souffre d’un syndrome de plus en plus répandu dans le secteur de l’économie tertiaire : il occupe un emploi dénué de sens. Un job à la con, ou bullshit job, en version originale.
Lire aussi : Comment trouver votre « bullshit job » de demain
A 27 ans, barbe de trois jours et chemise à carreaux, Paul Douard a déjà eu le temps de changer de vie. Bonne école de commerce, embauche dans une agence de communication, tout allait bien. Et là, le bullshit job, « ce métier impossible à définir en une phrase, ou même en moins de cinq minutes ». « Quand j’étais étudiant, l’été, j’étais déménageur et j’adorais ça. Le matin, il y avait une pièce pleine de meubles, le soir elle était vide, j’étais crevé, mais on voyait le camion et la famille partir, et tout ça avait du sens. »
« JE NE TRAVAILLAIS QUE SUR DES CHOSES DONT JE NE VOYAIS JAMAIS LA FIN, J’ÉTAIS PERDU AU MILIEU DE LA CHAÎNE DE PRODUCTION. » PAUL DOUARD, EX-EMPLOYÉ D’UNE AGENCE DE COMMUNICATION
Peut-être garde-t-il un souvenir un peu enjolivé de ses journées à porter des cartons, peut-être, aussi, ne l’a-t-il pas fait assez longtemps pour en éprouver la fatigue et la lassitude. Le « sens », en tout cas, était singulièrement absent de ses journées en entreprise, où s’enchaînaient tâches absurdes et réunions toutes les quatre heures, sans parler des centaines d’e-mails auxquels il devait répondre. Des journées dont l’événement le plus important était le déjeuner. « Je ne travaillais que sur des choses dont je ne voyais jamais la fin, j’étais perdu au milieu de la chaîne de production, et j’avais un vrai sentiment de rejet de la part de mes proches quand on me demandait ce que je faisais, je finissais par capituler et dire “tu as raison, je ne comprends même pas ce que je fais”. »
Paul Douard a tenu un an et demi. Il s’est depuis lancé dans le journalisme et ne regrette en rien « ces réunions où j’avais l’impression que mes collègues faisaient juste du bruit avec leur bouche ou ce goût pour les sigles incompréhensibles, comme pour installer une espèce de novlangue d’initiés… » Un vocabulaire qui peut même devenir l’objet d’un jeu comme celui développé par un ancien commercial atteint de « réunionite aiguë » dans sa société et qu’il a appelé le « bingo réunion ».
Bureaucratisation accélérée
Jean a lui aussi fait une prestigieuse grande école en trois lettres, pour aller contrôler la gestion d’une société de transports en quatre lettres. « Le matin, quand j’arrive, il y a un ordinateur éteint. Le soir, quand je finis ma journée, c’est à nouveau un ordinateur éteint, ce n’est pas comme un boulanger, ou un charpentier, je n’ai rien fabriqué », explique ce cadre de 38 ans. « Je mets des chiffres dans des cases, et je compte. Parfois, je compte même les cases pour m’amuser. C’est quand même fou le nombre de cases qu’il peut y avoir dans un tableur Excel », feint-il de s’extasier. Il se moque de sa propre condition mais, pour l’heure, il continue de regarder passer les trains. Peur du chômage ? De gagner en sens de la vie mais de perdre en niveau de vie ?
« REGARDEZ, MAINTENANT, ON PARLE BIEN DE LA “GESTION” DE SES AMIS OU DE SON CONJOINT AVEC DES PHRASES COMME “J’AI MAL GÉRÉ UNTEL”. » BÉATRICE HIBOU, CHERCHEUSE AU CNRS
Jobs à la con car tâches à la con, assure Béatrice Hibou, directrice de recherche, spécialisée en économie politique au CNRS, qui constate une bureaucratisation accélérée du monde du travail : « Même nous, les chercheurs, on passe plus de temps à remplir des formulaires, à se conformer à des procédures, à s’envoyer des e-mails dans tous les sens pour prendre des décisions, qu’à vraiment faire de la recherche », regrette-t-elle.
Entre la logique de compétitivité, qui nécessite une évaluation permanente, et celle de sécurité, qui entraîne une explosion des normes, on assiste à une extension du domaine du management, et de son vocabulaire qui s’infiltre partout. « Regardez, maintenant, on parle bien de la “gestion” de ses amis ou de son conjoint, avec des phrases comme “j’ai mal géré untel”, poursuit Béatrice Hibou. On utilise des outils de planification d’entreprise pour notre vie personnelle, comme le Doodle pour organiser une soirée ou un week-end… »
Des « bullshit jobs » a découlé un autre phénomène : le « bore-out », des crises d’ennui provoquées par l’absence de sens dans son travail. | Muriel Bordier
En 2013, la même année que le succès des Fauve, c’est un article signé de David Graeber, « Sur le phénomène des jobs à la con », qui avait conceptualisé les bullshit jobs. Anthropologue à la London School of Economics, amateur de pantalons en flanelle et de barricades altermondialistes – il est venu à la rencontre des militants de Nuit Debout, à Paris, à la mi-avril, et était l’un des piliers du mouvement Occupy Wall Street –, ce chercheur américain affirmait que les progrès technologiques, loin de réaliser la prophétie de Keynes, qui imaginait l’avènement d’une semaine limitée à quinze heures travaillées, auraient à l’inverse permis l’explosion et la prédominance du secteur administratif. « Dans la théorie économique du capitalisme (…), la dernière chose que le marché et l’entreprise sont censés faire, c’est de donner de l’argent à des travailleurs qui ne servent à rien, écrit David Graeber. C’est pourtant bien ce qu’il se passe ! La plupart des gens travaillent efficacement probablement pendant quinze heures par semaine, comme l’avait prédit Keynes, et le reste du temps, ils le passent à critiquer l’organisation, organiser des séminaires de motivation, mettre à jour leurs profils Facebook et télécharger des séries TV. »
« L’équivalent de la chaîne de montage au bureau »
L’hebdomadaire libéral britannique The Economist a répondu par une charge étayée, rappelant que chaque période a connu sesbullshit jobs, en particulier la révolution industrielle. Avant l’automatisation des tâches, écrit le journal, le quotidien des ouvriers à la chaîne était « terriblement ennuyeux et déplaisant ». Les emplois administratifs ont désormais supplanté les trois-huit, dès lors, rien de surprenant à ce qu’émerge « l’équivalent de la chaîne de montage au bureau. Les premiers passaient leur temps à assembler les pièces, les seconds trient des papiers, gèrent des détails logistiques, etc. Certes, la dématérialisation peut donner une impression de vacuité (…), puisque l’époque où le minerai de fer se transformait en voitures est révolue. Mais l’idée reste la même ».L’automatisation des emplois administratifs soulagerait peut-être les détenteurs de bullshit jobs, conclut The Economist. Mais il y a peu de chance qu’émerge une nouvelle génération de métiers « passionnants et pleins de sens. (…) Il est assez probable que les jobs à la con dans l’administration ne soient qu’une transition entre les jobs à la con dans l’industrie et pas de job du tout. »
Lire aussi : Malades d’ennui au travail : après le burn-out, le « bore-out » (édition abonnés)
Le débat reste ouvert. David Graeber le reconnaît lui-même dans son article, son concept de bullshit jobs n’est pas très précis. Rien de plus subjectif que le sens et sa quête. Mais malgré la polémique, sa thèse gagne du terrain et les esprits. Après le bullshit job, un autre néologisme est apparu pour décrire ces supposées crises d’ennui liées à l’absence de sens au travail : le bore-out, par opposition au « burn-out » propre aux excès de travail.
« ON FAIT DE BONNES ÉTUDES AVEC L’IMPRESSION QU’ON A PLEIN DE CHOSES À DIRE AU MONDE, ET ON ARRIVE SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL DANS DE GRANDES SOCIÉTÉS OÙ ON EST JUSTE UN TOUT PETIT MAILLON DE LA CHAÎNE. » ANNE
Cette génération de consultants hyperspécialisés et autres chefs de projet a quand même des traits communs : ils ont souvent fait de longues études supérieures et leur crise survient en général au moment de devenir senior à leur poste. Anne, une trentenaire au carré fraîchement coupé, décrit bien ce mécanisme. « On fait de bonnes études avec l’impression qu’on a plein de choses à dire au monde, et on arrive sur le marché du travail dans de grandes sociétés où on est juste un tout petit maillon de la chaîne, avec notre badge, notre petit bureau “open space” dans la tour immense, et la machine à café comme seul horizon. On se sent un peu arnaqués. » Plutôt que d’accepter que « ça sera vraiment ça toute notre vie », ils déploient alors des trésors d’inventivité pour aller chercher ailleurs un sens qu’ils ne trouvent plus. Il y a trois ans, Anne s’est lancée dans des études de sociologie. Pour nombre de ses congénères, cela se traduit par une avalanche de reconversions artistiques, de tours du monde, ou d’entrepreneuriats en tout genre, du miel bio à la chaussure péruvienne.
Une profession reconnue socialement
Ou encore de départs chez Emmaüs. Valérie Fayard, secrétaire générale adjointe de l’association, a lâché un de ces emplois il y a quinze ans, pour devenir bénévole et grimper un à un les échelons. Depuis quelques années, atterrissent sur son bureau les excellents CV de ces jeunes diplômés en quête de sens. Ils n’ont jamais été aussi nombreux, dit-elle. « Ma contrôleuse de gestion a exactement ce profil, elle vient du cabinet d’audit KPMG et voulait autre chose que “marge, profit, actionnaire”. Elle a divisé son salaire par deux, mais le sens et le bonheur d’avoir une profession reconnue socialement, qu’elle peut facilement expliquer dans une soirée, ça n’a pas de prix. »
Quant aux musiciens de Fauve, ils ont refusé de devenir les porte-parole de la « génération bullshit ». Ils ne jouent plus Sainte-Annedans leurs concerts et bientôt, ils ne vont plus jouer du tout. Après trois années de succès, le collectif est en voie de dissolution. « On ne veut pas que ça devienne une routine : à notre premier concert à Paris, on était malades de stress. Maintenant, un concert devant des milliers de personnes, c’est comme aller au supermarché. » Si même le métier de rock star devient un bullshit job…
Lire aussi : Petits patrons, grosses déprimes (édition abonnés)