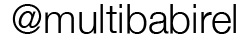Etre noir aux Etats-Unis, c’est être louche
LE MONDE IDEES
Le 19 janvier 2017 à 15h22
Mis à jour le 22 janvier 2017 à 07h45
Grand marcheur de rue, le Jamaïcain Garnette Cadogan raconte les stratégies qu’il doit sans cesse déployer pour se protéger des passants comme des policiers américains.
Garnette Cadogan, journaliste et essayiste, est né à Kingston (Jamaïque) et vit aux Etats-Unis. | DR
Mon amour de la marche m’est venu dès l’enfance, par nécessité. Comme mon beau-père avait la main lourde, je ne manquais jamais une occasion de sortir. J’étais souvent dehors – chez un ami ou à des fêtes de quartier où un mineur n’avait pas sa place – bien après l’heure du dernier bus. Alors, je marchais.
Dans les années 1980, les rues de Kingston, en Jamaïque, pouvaient être terrifiantes. Vous risquiez, par exemple, de vous faire tuer par l’homme de main d’un parti politique s’il s’était mis en tête que vous veniez du mauvais quartier, ou si vous portiez la mauvaise couleur. L’orange montrait l’appartenance à l’un des deux partis, le vert à l’autre : il fallait bien choisir votre tenue si vous étiez neutre et que vous vous aventuriez loin de chez vous. Porter la mauvaise couleur dans le mauvais quartier pouvait signer votre arrêt de mort. Pas étonnant, donc, que mes amis et les rares passants nocturnes aient pensé, à l’époque, que mes longues balades à point d’heure à travers des faubourgs rivaux étaient une pure folie. (…)
« J’étais considéré comme une menace »
J’ai quitté la Jamaïque en 1996 pour suivre des études supérieures à La Nouvelle-Orléans, dont j’avais entendu dire qu’elle était « la ville caribéenne la plus au nord du continent ». Je voulais découvrir – à pied, bien sûr – ce qu’elle avait de caribéen et de nord-américain. Demeures patriciennes le long d’avenues bordées de chênes et animées par le staccato des tramways, maisons peintes de couleurs vives qui donnaient un air de fête à des quartiers entiers, groupes en costumes splendides dansant en pleine rue au rythme de fanfares funky, cuisine et arômes mêlant les traditions africaines, européennes, asiatiques et du sud des Etats-Unis ; mariage du Vieux et du Nouveau Monde, de l’étonnant et du familier : qui n’aurait pas été tenté d’explorer tout ça ?
Dès le premier jour, j’ai marché quelques heures pour prendre le pouls de la ville et trouver de quoi rendre plus accueillante ma chambre à la cité universitaire, une vraie cellule de prison. Des membres de l’université, lorsqu’ils l’ont su, m’ont conseillé de me cantonner aux zones jugées sûres pour les touristes et les parents d’étudiants en visite. Ils m’ont débité les statistiques sur le taux de criminalité local. Mais celui de Kingston l’éclipsait de loin, et j’ai ignoré ces mises en garde bien intentionnées. J’avais une ville à découvrir, je n’allais pas laisser des chiffres m’en empêcher. Ces criminels américains n’étaient rien à côté de ceux de ma cité natale, avais-je décidé. Pour moi, ils ne présentaient pas une réelle menace.
Personne ne m’avait dit que c’est moi qui allais être considéré comme une menace.
UN JOUR, J’AI VOULU AIDER UN HOMME DONT LE FAUTEUIL ROULANT S’ÉTAIT BLOQUÉ AU MILIEU D’UN PASSAGE PIÉTON ; IL M’A MENACÉ DE ME TIRER UNE BALLE EN PLEINE FIGURE, PUIS A DEMANDÉ DE L’AIDE À UN PASSANT BLANC
Au bout de quelques jours, j’ai remarqué que ma présence semblait inquiéter les passants : certains changeaient de trottoir après m’avoir lancé un regard méfiant, d’autres accéléraient soudain quand ils me voyaient marcher derrière eux ; des vieilles dames blanches se cramponnaient à leur sac à main, des garçons blancs me saluaient nerveusement, comme pour se rassurer : « Ça va, mec ? » Un jour, moins d’un mois après mon arrivée, j’ai voulu aider un homme dont le fauteuil roulant s’était bloqué au milieu d’un passage piéton ; il m’a menacé de me tirer une balle en pleine figure, puis a demandé de l’aide à un passant blanc.
Rien ne m’avait préparé à cela. Je venais d’un pays à grande majorité noire, où personne ne se méfiait de moi à cause de la couleur de ma peau. Là, j’en venais à me demander qui n’avait pas peur de moi. Le comportement de la police, surtout, me déconcertait : régulièrement, les flics m’interpellaient brutalement et leurs questions montraient qu’ils me croyaient coupable. Je n’avais jamais reçu ce que nombre de mes amis africains-américains appellent « le Topo » : mes parents ne m’avaient pas expliqué comment me conduire en face d’un policier – me montrer aussi poli et aimable que possible, quels que soient ses paroles ou ses actes. J’ai donc dû improviser mon propre code de conduite : forcer sur mon accent jamaïcain, mentionner en passant le nom de mon université, sortir « fortuitement » ma carte d’étudiant quand ils voulaient voir mon permis de conduire…
L’ENSEMBLE JEAN ET TEE-SHIRT BLANC, CE GRAND CLASSIQUE AMÉRICAIN, M’ÉTAIT INTERDIT SI JE VOULAIS GARDER MA LIBERTÉ DE MOUVEMENT : TROP DE POLICIERS Y VOYAIENT L’UNIFORME DES DÉLINQUANTS NOIRS
Les trottoirs un champ de mines
Ces tactiques d’autopréservation commençaient bien avant que je ne quitte ma chambre. En sortant de la douche, j’avais déjà la police en tête quand je choisissais ma tenue. Chemise de couleur claire. Pull à col en V. Pantalon de toile. Bottines. Sweat-shirt ou T-shirt à l’emblème de mon université.
Puisqu’on s’intéressait tant à mon identité, je tâchais de donner l’image d’un étudiant de l’Ivy League – même si, par la suite, j’y ai ajouté une touche jamaïcaine en portant des Clark’s couleur sable, chaussures de prédilection des branchés de Kingston. Mais l’ensemble jean et tee-shirt blanc, ce grand classique américain, m’était interdit si je voulais garder ma liberté de mouvement : trop de policiers y voyaient l’uniforme des délinquants noirs.
Dans cette ville aux rues exubérantes, la marche s’est révélée un exercice à la planification complexe et souvent oppressante. Si une femme blanche arrivait dans ma direction la nuit tombée, je changeais de trottoir pour la rassurer. Si j’avais oublié quelque chose dans ma chambre, avant de rebrousser chemin, je m’assurais que personne ne marchait derrière moi pour ne pas provoquer un sursaut affolé.
La règle absolue, c’était de garder mes distances avec ceux qui pourraient me juger dangereux, sous peine de me mettre moi-même en danger. Soudain, La Nouvelle-Orléans semblait bien plus inquiétante que Kingston. Les trottoirs étaient des champs de mines, la moindre hésitation, chaque précaution compromettait ma dignité. Malgré tous mes efforts, je ne me sentais jamais en sécurité. Un simple hochement de tête était suspect.
Un soir, huit ans après mon arrivée, alors que je rentrais chez moi, j’ai fait signe à un flic qui passait en voiture. En un rien de temps, j’étais plaqué contre le véhicule, les mains menottées dans le dos. Quand je lui ai demandé ensuite pourquoi il m’avait appréhendé – d’un air penaud bien sûr, tout autre ton m’aurait valu des coups –, il m’a répondu que mon geste lui avait paru louche : « Personne ne fait de signe à la police », a-t-il expliqué. (…)
Pas invulnérable
Je suis parti à New York, prêt à me perdre dans « les foules de Manhattan et sa musique aux refrains sauvages » que chantait Walt Whitman. J’ai été émerveillé par « le ballet des trottoirs de la bonne ville » que Jane Jacobs admirait dans son vieux quartier, le West Village. J’ai marché le long des gratte-ciel du centre déversant dans la rue leurs foules animées, jusqu’à l’Upper West Side et ses majestueux immeubles néoclassiques, ses résidents stylés, ses artères pleines de vie.
Plus loin, c’était Washington Heights et son mélange exubérant de juifs et de Dominicains-Américains, jeunes et vieux, puis Inwood dont les collines boisées offrent des vues splendides sur le fleuve Hudson, et enfin chez moi, Kingsbridge dans le Bronx, ses rangées de pavillons et d’immeubles de brique côtoyant l’effervescent Broadway et les sereines étendues du parc Van Cortlandt. Je suis allé à Jackson Heights, dans le Queens, pour voir les cours arborées où les habitants bavardaient en ourdu, coréen, espagnol, russe ou hindi. Et quand j’avais le mal du pays, je me dirigeais vers Crown Heights, à Brooklyn, où je retrouvais la cuisine, la musique et l’humour de la Jamaïque mâtinés d’esprit new-yorkais. La ville était mon terrain de jeux.
A New York, en 2001. | CONSTANTINE MANOS / MAGNUM PHOTOS
J’ai exploré New York avec des amis, puis avec la jeune femme que je commençais à fréquenter. (…) En écho à mes émotions pour elle, ces premiers mois d’exploration urbaine ont été pétris de romantisme. La ville était séduisante, enthousiasmante, intense. Mais très vite, la réalité m’a rappelé que je n’étais pas invulnérable, surtout quand je marchais seul.
Nervosité et suspicion
Un soir, dans l’East Village, alors que je me hâtais de rejoindre un dîner, un homme blanc qui marchait devant moi s’est soudain retourné et m’a frappé au torse si brutalement que j’ai cru que mes côtes s’étaient enroulées autour de ma colonne vertébrale. J’ai d’abord cru qu’il était saoul ou qu’il m’avait confondu avec un de ses ennemis, avant de comprendre que, vu ma race, il avait simplement pensé que je lui courais après avec des intentions criminelles. Lorsqu’il s’est rendu compte qu’il s’était trompé, il m’a dit que sa réaction était de ma faute, puisque je courais derrière lui.
Si j’ai réussi à voir dans cet incident une aberration, la méfiance mutuelle entre la police et moi était impossible à relativiser. C’était quelque chose de primaire. Une patrouille arrivait sur le quai du métro ; je les remarquais tout de suite (et je voyais tous les autres hommes noirs prendre note de leur présence, alors que personne d’autre ou presque n’y prêtait attention). Ils balayaient le quai du regard. Je sentais la nervosité monter en moi et je risquais un coup d’œil furtif. Ils m’observaient avec insistance. Mon inconfort grandissait. Je soutenais leur regard, craignant de leur sembler suspect. Mon attitude renforçait leur suspicion. Cet échange tacite et tendu se poursuivait jusqu’à ce que la rame arrive, nous séparant enfin.
NE JAMAIS COURIR, SURTOUT LA NUIT. PAS DE MOUVEMENTS BRUSQUES, PAS DE CAPUCHON SUR LA TÊTE, PAS D’OBJET À LA MAIN, SURTOUT BRILLANT. NE JAMAIS ATTENDRE DES AMIS À UN COIN DE RUE, AU RISQUE D’ÊTRE PRIS POUR UN DEALER
Je suis revenu aux règles que je m’étais fixées à La Nouvelle-Orléans, en les complétant. Ne jamais courir, surtout la nuit. Pas de mouvements brusques, pas de capuchon sur la tête, pas d’objet à la main, surtout brillant. Ne jamais attendre des amis à un coin de rue, au risque d’être pris pour un dealeur ; pour la même raison, ne jamais s’y arrêter pour passer un coup de fil… Mais à mesure que je me sentais plus en confiance, le respect de ces consignes s’est relâché. Jusqu’à ce qu’une rencontre nocturne m’y ramène brutalement.
Après un bon dîner dans un restaurant italien en compagnie d’amis, je courais vers la station de métro Columbus Circle, en retard pour rejoindre un autre groupe d’amis à un concert, quand j’ai entendu crier. Levant les yeux, j’ai vu un policier avancer vers moi, arme au poing. « Contre la voiture ! » En un rien de temps, j’ai été entouré par une demi-douzaine de flics. Ils m’ont poussé sans ménagement contre le capot en me menottant. « Pourquoi tu courais ? », « Où tu allais ? », « D’où tu viens ? », « J’ai dit : où tu courais comme ça ? »… Comme je ne pouvais pas répondre à tous, j’ai décidé de m’adresser d’abord à celui qui semblait le plus disposé à me frapper. Pris dans cet essaim agressif, j’essayais de me concentrer sur un seul d’entre eux sans pour autant fâcher ses collègues.
Ça n’a pas marché. Furieux de voir que je ne tenais compte que d’une question, les autres se sont mis à me hurler dessus. Fouillant mes poches, que j’avais pourtant déjà vidées, l’un d’eux m’a demandé si j’avais une arme sur moi, ce qui sonnait plus comme une accusation que comme une interrogation. Un autre me demandait sans cesse d’où je venais, comme si au bout de la quinzième fois je finirais par avouer ce qu’il imaginait être la vérité. Je répétais calmement – c’est-à-dire en essayant de ne tenir compte ni de mon cœur affolé ni des postillons dont ils me couvraient le visage en vociférant – que je venais de quitter mes amis à deux pâtés de maisons de là, qu’ils étaient encore au restaurant et pourraient se porter garants de moi, que les textos m’invitant au concert où je me rendais étaient toujours dans mon téléphone, oui Monsieur, oui officier, bien sûr officier, mais cela n’a servi à rien.
UN TÉMOIN NOIR POSANT UNE QUESTION OU PROTESTANT POLIMENT A TOUTES LES CHANCES DE SE RETROUVER EN PRISON AUX CÔTÉS DU PRÉTENDU SUSPECT. POUR SE SORTIR DE CE GENRE D’INCIDENT, LA DÉFÉRENCE ENVERS LA POLICE EST UNE CONDITION SINE QUA NON
« Ils semblaient penser que je le méritais »
Affirmer sa dignité devant la police, pour un Noir, c’est encourir des violences. Les forces de l’ordre n’ont pas de considération pour la dignité des Noirs, et c’est pourquoi je me suis toujours senti plus en sécurité quand j’étais arrêté devant des témoins blancs plutôt que devant des Noirs : les flics se soucient peu du témoignage ou des protestations de spectateurs noirs, tandis que les objections de Blancs ont généralement plus d’effet sur eux. Un témoin noir posant une question ou protestant poliment a toutes les chances de se retrouver en prison aux côtés du prétendu suspect. Pour se sortir de ce genre d’incident, la déférence envers la police est une condition sine qua non.
Ignorant mes explications, ils ont continué à aboyer. Tous, sauf un capitaine. Il a posé une main sur mon dos et il a lancé : « S’il avait couru depuis longtemps, il serait en nage. » Puis il a donné l’ordre de me retirer les menottes. Il m’a expliqué qu’un Noir avait attaqué quelqu’un au couteau à deux ou trois pâtés de maisons de là et qu’ils étaient à sa recherche. Je n’avais pas de taches de sang sur moi et j’avais donné à l’escouade mon alibi – qui, techniquement, n’en était pas un, puisque personne ne m’avait dit pourquoi on m’arrêtait et que je n’avais pas osé le demander –, ainsi que le moyen de le vérifier. De toute évidence, tout ce qui n’était pas une attitude prostrée aurait été pris comme une agression.
Le capitaine m’a dit que je pouvais y aller. Aucun des flics n’a jugé nécessaire de s’excuser : ils semblaient penser, comme la brute de l’East Village, que je n’avais récolté que ce que je méritais en courant. Humilié, j’ai évité le regard des badauds sur le trottoir, hésitant à passer à travers ce groupe pour reprendre mon chemin. Comprenant peut-être ma gêne, le capitaine m’a proposé de me conduire en voiture jusqu’à la bouche de métro. Quand je l’ai remercié de m’avoir déposé, il a eu ces mots : « C’est parce que vous avez été poli qu’on vous a laissé repartir. Si vous aviez joué au petit malin, ça ne se serait pas passé comme ça. » J’ai hoché la tête sans rien dire.
Je me suis aperçu que ce que j’aimais le moins, dans mes déambulations new-yorkaises, n’était pas d’avoir à apprendre de nouveaux codes de navigation et de comportement social. Chaque ville a les siens. Non, c’était plutôt le caractère arbitraire des circonstances qui les requéraient. Cela me donnait l’impression de retomber en enfance, d’être infantilisé : quand nous apprenons à marcher, le monde entier menace de nous foncer dessus. Le moindre pas est un risque. Nous apprenons que, pour marcher sans nous cogner partout, il faut rester attentif à nos mouvements et, surtout, à ce qui nous entoure. Une fois adulte, nous marchons sans vraiment y penser. Mais moi, adulte noir, je suis souvent ramené à ce moment de l’enfance où j’ai appris à marcher. A nouveau, je dois être constamment en alerte, sans cesse vigilant. (…)
Tour à tour invisible et trop voyant
Marcher quand on est noir restreint l’expérience de la marche à pied et rend inaccessible le plaisir de la promenade solitaire, si chère aux romantiques. Je dois me soucier sans cesse des autres, incapable de me mêler à ces flâneurs new-yorkais croisés dans les livres et que j’avais espéré rejoindre. Au lieu de marcher sans but sur les traces de Whitman, de Melville, d’Alfred Kazin et de Vivian Gornick, j’avais souvent l’impression d’avancer sur la pointe des pieds derrière James Baldwin, qui écrivait déjà en 1960 :
« Rares sont les citoyens de Harlem, du paroissien le plus scrupuleux à l’adolescent le plus indolent, qui n’ont pas une longue histoire à raconter sur l’incompétence, l’injustice ou la brutalité de la police. Pour ma part, j’ai été plus d’une fois témoin ou victime de tels comportements. »
Marcheur et Noir, je me suis senti à la fois rejeté par la ville, à cause de cette sensation d’être sans cesse suspect, mais aussi plus en phase avec elle, grâce à l’attention redoublée qu’imposait ma vigilance. Mes marches sont devenues plus volontaires et j’ai fini par m’intégrer à la foule plutôt que de rester sur le côté à l’observer.
Mais cela signifie également que j’en suis encore à tenter de vivre dans une ville qui n’est pas tout à fait la mienne. Nous sommes « chez nous » là où nous pouvons vraiment être nous-mêmes. Et sommes-nous jamais plus nous-mêmes que quand nous marchons, cet état naturel par lequel nous répétons l’une des premières actions que nous ayons apprises ? Marcher, cet acte simple et monotone qui consiste à poser un pied devant l’autre pour éviter de tomber, n’est pas si évident quand on est un Noir. Et marcher seul n’a rien de monotone pour moi ; la monotonie est un luxe.
APPRENDRE À CONNAÎTRE LES RUES DE NEW YORK M’A AIDÉ À M’Y SENTIR CHEZ MOI, MAIS CES RUES SONT AUSSI CE PAR QUOI LA VILLE SE REFUSE À MOI. J’Y MARCHE, TOUR À TOUR INVISIBLE ET TROP VOYANT
Nous levons un pied, posons l’autre, et nos désirs nous propulsent d’un temps de repos au suivant. Le désir de voir, de penser, de parler, de s’échapper. Mais, plus que tout, le désir d’être libre. Nous aspirons à la liberté et au plaisir de marcher sans crainte – et sans être craint. Voilà près de dix ans que je vis à New York et je n’ai jamais cessé d’arpenter ses rues fascinantes. Je n’ai pas non plus abandonné le désir d’y retrouver le réconfort que m’apportaient, enfant, les rues de Kingston. Apprendre à connaître les rues de New York m’a aidé à m’y sentir chez moi, mais ces rues sont aussi ce par quoi la ville se refuse à moi. J’y marche, tour à tour invisible et trop voyant. J’avance, pris entre la mémoire et l’oubli, entre les souvenirs et le pardon.
(Traduit de l’anglais par Bernard Cohen.)
Cet essai, ici en partie abrégé, a été initialement publié en octobre 2015 dans le premier numéro de la revue américaine Freeman’s. Il figure dans l’anthologie The Fire this Time. A New Generation Speaks about Race, éditée par Jesmyn Ward (Scribner, 2016).