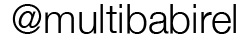ECOLOGIE
Le monde est un champignon sauvage dans une forêt détruite
03 SEPTEMBRE 2017 | PAR JADE LINDGAARD
Plutôt que de contempler la destruction du monde, tentons de comprendre à quelles conditions il est possible de vivre dans les ruines du capitalisme. C’est le point de départ d’un livre magistral, Le champignon de la fin du monde, de l’anthropologue Anna L. Tsing.
Catastrophe, désastre, effondrement, anthropocène : un glossaire de la destruction a envahi les tribunes de journaux et les rayons de bibliothèque des lecteurs sensibles aux conséquences délétères des dérèglements climatiques et du capitalisme.
Que faire de ce savoir sur les démolitions en cours ? Le point de départ d’un voyage à travers les ruines du monde pour comprendre comment, malgré tout, on continue d’y vivre, propose l’anthropologue Anna L. Tsing dans un livre extraordinaire, tout juste traduit en français, Le champignon de la fin du monde. Et pour suivre ce grand dessein, la chercheuse choisit de raconter l’histoire d’un champignon sauvage, le matsutake.

La particularité de cette espèce rare est de pousser dans les forêts qui ont été surexploitées par les humain.e.s. « Comme les rats, les ratons-laveurs et les cafards, ils sont prêts à supporter une partie du désordre environnemental que les humains ont créé », explique-t-elle en introduction. Le matsutake apprécie les forêts de l’Oregon, sur la côte ouest des États-Unis, victimes de déboisement intensif au XXe siècle. La disparition des arbres les plus grands et les plus forts a laissé la place aux pins, qui sont l’espèce compagne du matsutake. Mythifié au Japon pour sa rareté et son arôme singulier, il fait l’objet d’un commerce international lucratif et codifié. Il est donc aussi un véhicule de mondialisation. Au fil des pages, le petit champignon prend de l’épaisseur sous la plume de l’auteure : espèces survivante, délice gastronomique, figure poétique, objet de spéculation. Il est tout à la fois être discret de la forêt et témoin direct des transformations du système de production de valeurs.
Partie en promenade de cueillette dans les bois au début du livre, Tsing rencontre des migrants du Sud-Est asiatique qui vivent de la vente du matsutake, si difficile à dénicher sous l’humus des feuilles. À sa surprise, elle découvre que des Mien, Hmong et Lao reconstituent dans la forêt américaine des campements villageois semblables à ceux qu’ils ont connu de l’autre côté du Pacifique, souvent sur les routes de l’exil. Dans la forêt américaine, ils côtoient d’anciens soldats de la guerre du Vietnam, des hippies et des survivalistes qui, eux aussi, y ont trouvé un refuge. Autour du champignon, des communautés de vies précaires se sont reconstituées. La chercheuse part à leur rencontre sur d’autres continents : en Chine, au Japon, en Finlande. Son texte palpite de bruits forestiers et de voix aux accents multiples, habitées de mille manière par un incroyable enchevêtrement d’humain.e.s, de végétaux et d’animaux, les « plus qu’humains » que décrit David Abram dans un autre livre prodigieux de cette même collection dirigée par Philippe Pignarre : Comment la terre s’est tue (La Découverte).
Le matsutake est le guide d’Anna L. Tsing dans son périple, mais il n’est pas le but de sa recherche. À quelles conditions la vie est-elle toujours possible dans les ruines du capitalisme ? La question organise tout son récit. La chercheuse récolte des réponses, qu’elle amène par petites touches, en de courts chapitres, tissés de descriptions de choses vues. Cette forme n’est pas fortuite. Car une des grandes idées du livre est d’interroger la notion d’échelle : nul besoin qu’une expérience soit systémique pour qu’elle vaille la peine d’être observée, partagée et reconnue.
Elle propose de réfléchir en termes de « scalabilité », c’est-à-dire « la capacité d’un projet à changer d’échelle sans problème, c’est-à-dire sans que se modifie en aucune manière le cadre qui définit ce projet ». Une entreprise garde la même organisation même si elle se met à produire beaucoup plus, une recherche scientifique ne prend en compte que les données avalisées par les pairs. C’est un problème, car la scalabilité élimine la diversité, celle « qui pourrait bouleverser l’ordre des choses ». Tsing s’appuie sur l’exemple de la plantation coloniale qui a inspiré les formes de l’industrialisation et de la modernisation. Les Européens ont planté la même canne à sucre, clonée et interchangeable, partout. Elle n’avait pas d’espèces compagnes dans le Nouveau Monde. Les esclaves africains exploités dans les plantations étaient eux aussi parfaitement isolés de l’extérieur. Le système les déshumanisait et les rendait interchangeables. Il était scalable : les plantations pouvaient grandir et s’étendre, et leur régime d’aliénation avec elles. « Cette formule a donné sa forme aux rêves que nous avons appelés progrès et modernité », décrit Tsing.
 Anna L. Tsing, anthropologue à l’université de Californie, Santa Cruz (DR)
Anna L. Tsing, anthropologue à l’université de Californie, Santa Cruz (DR)
La forêt de matsutake propose une expérience inverse : le fameux champignon « ne peut pas vivre en dehors de ses relations transformatrices avec les autres espèces. Ils sont la structure reproductrice d’un système souterrain qui ne s’associe qu’à certains arbres de la forêt. Les matsutake permettent à leurs abris hôtes de vivre sur des sols pauvres sans humus. En échange ils sont nourris par les arbres. Ce mutualisme transformatif a rendu impossible la culture humaine du matsutake. Il résiste au système de type plantation. Il a besoin de la diversité dynamique et multispécifique de la forêt avec laquelle il peut nouer des rapports cordiaux de contamination ». Tsing refuse de considérer comme mauvais ce qui est scalable et bon ce qui ne l’est pas. C’est la diversité, l’indétermination, la précarité qui se jouent dans ces agencements qui l’intéressent. Une force incroyable peut y naître, mais « elle peut aussi disparaître en un instant ».
À partir de là, de nouveaux savoirs deviennent possibles : donner de la valeur aux contaminations vues comme des formes métisses de collaboration, reconnaître l’existence de « communs latents » dans les écosystèmes et de pratiques de coopération qui ne sont pas exclusivement humaines. Ainsi, la chercheuse développe au fil de son texte, ponctué de photos prises sur le terrain, comme dans un carnet de travail, l’idée que le changement social ne peut plus se penser sans la collaboration des humain.e.s avec les autres êtres vivants. Que les savoirs précaires, les pratiques fragiles peuvent être aussi importants que les grandes théories bien carrées. Que pour comprendre ces réalités mouvantes, il ne faut pas seulement produire des enquêtes scientifiques, il faut aussi savoir écouter et raconter des histoires.
« À la question de la possibilité de vie dans les ruines du capitalisme, il n’y a pas de réponse globale, analyse la philosophe Isabelle Stengers en préface du livre. Les ruines, lieux de rencontres marquées par la contingence, de connexions marquées par la précarité, ne donnent pas d’assurance et le livre de Tsing n’en donne pas non plus. » De l’ouvrage, elle extrait la notion de « viabilité » : « La question “est-ce viable ?” sera peut-être la question rationnelle par excellence », écrit-elle. Viable pour qui et aux dépends de quoi ? Chaque piste ouverte par le livre de Tsing amorce de nouvelles questions.
Ce monde fragile et coopératif qui se fabrique autour du matsutake n’est ni un modèle ni une dystopie. Il présente des aspects admirables (courage des chercheurs de champignons, solidarité des bivouacs, amour de ses admirateurs pour la beauté des saisons) et des revers (cynisme commercial, défense de son territoire). Tsing ne le juge pas. Elle le repère et elle le situe sur la carte des lieux d’expérimentations sociales. Elle invite son lecteur à déplacer son regard sur son environnement direct et à y déceler les agencements entre humain.e.s et non-humain.e.s, entre survie économique et liberté subjective, entre rationalisation et émotion. Le texte et les images qu’il convoque continuent de vous habiter bien après en avoir terminé la lecture. Petit à petit, le matsutake vous prend dans ses filets.